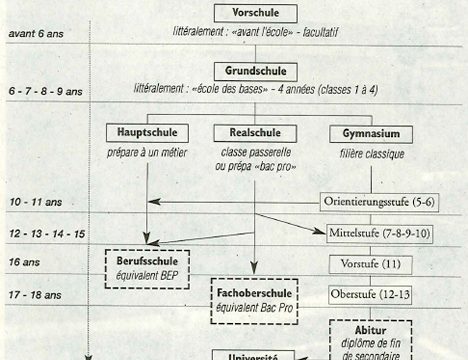T
Le nom même de mammouth, choisi par notre ministre pour définir notre école, repris par les médias, et finalement adopté par la plupart, appelle une petite remarque. Faire référence au mammouth c’est, nous semble t-il, comprendre que notre école est une école fossile, un vestige des temps anciens – c’est admettre également, aussi forte soit notre volonté et ténue notre ténacité, qu’en le dégraissant nous ne le ferons jamais renaître. Car le destin de ce fossile est réglé depuis des lustres : trace d’un autre monde il est, trace d’un autre monde il restera !
Une question se pose alors avec évidence : N’est-il pas temps, sinon d’oublier ce monstre, du moins de ranger sa carcasse dans un coin poussiéreux de notre passé ?
Là, les avis divergent. A en croire l’opinion (du moins les politiques et les administratifs !) les Français aiment cette grosse bête. Pas question, donc, de la trop changer. Les Français, nous dit-on, sont attachés à leur école pour deux raisons principales : 1° – Son niveau est très élevé (on entend couramment des politiques, et ce quelque soit leur tendance, parler d”une des meilleures écoles du monde’). 2° Ses structures permettent de lutter contre les inégalités.
Or ces deux affirmations méritent d’être largement nuancées.
L’école française n’est certainement pas plus mauvaise qu’une autre – mais elle n’est pas non plus, comme on veut nous le faire croire, la seule qui soit performante, la seule qui forme une jeunesse cultivée et intelligente ! Elle a, au niveau des résultats, ses failles et ses faiblesses.
Quant au second point (la France posséderait un système éducatif tendant à réduire les inégalités), il convient de le balayer. Les chiffres prouvent en effet le contraire. Ils disent même clairement que notre école amplifie les inégalités et que ces dernières se creusent un peu plus d’année en année (y compris dans les lycées les plus favorisés). Nous rappellerons à ceux qui en doutent que les fameux casseurs de manifestations d’octobre dernier (les nouveaux lanceurs de pavés) ne représentent qu’une infime partie des adolescents que l’école a (et sans qu’elle en soit la seule responsable) laissés sur le pavé.
Sous prétexte d’entretenir ces deux mythes de la performance et de l’égalité, il nous paraît malsain de s’abriter derrière eux, d’occulter, à l’intérieur de l’institution, certains débats (et notamment le débat fondamental sur la définition et le rôle d’une école moderne) et de refuser de se poser quelques questions essentielles. Des questions comme celles-ci : la culture de ‘l’esprit de compétition’ dès la petite enfance n’est-elle pas préjudiciable à un développement harmonieux d’une classe et d’un enfant? Faut-il noter les élèves du primaire, et si oui sur quelle base? Le système de notation globale – une note pour un devoir – n’est-il pas totalement dépassé ? Le baccalauréat remplit-il sa fonction ? (Au fait quelle est cette fonction ?) Cet examen n’a t-il pas – tel qu’il est conçu aujourd’hui – des effets très néfastes sur la formation de notre jeunesse ? Est-il admissible que certains lycéens travaillent plus de 60 heures par semaine (40 heures de cours + travail personnel) ? Les élèves reçoivent-ils de la part du monde enseignant l’attention qu’ils sont en droit d’espérer? Les professeurs peuvent-ils travailler en sentant leur autorité bousculée ? Les rapports entre enseignants et élèves ont-ils évolué assez vite, sont-ils adaptés, doivent-ils rester uniquement verticaux (le savoir et le pouvoir trônant au sommet de la pyramide)? Dans l’état actuel des choses, il nous semble inconcevable que la France fasse l’économie de questions qui animent depuis si longtemps la plupart des pays étrangers. Il nous semble évident que l’heure de l’examen de conscience de notre école a sonné.
Venons-en maintenant aux événements récents. Au départ, le mouvement des lycéens apparaît d’abord comme anodin. La revendication de ces derniers est, somme toute, assez classique. Elle porte en effet sur l’argent, les profs et les locaux. Elle révèle en même temps un certain malaise, et nous appelle à faire quatre remarques :
1°) Cette revendication ressemble étrangement à celle des professeurs. Or, il n’est pas certain que dans la conjoncture actuelle les intérêts des uns et des autres soient nécessairement convergents.
2°) Aussi légitime soit-elle, cette revendication, a priori purement matérielle, est une façon bien inefficace d’aller au fond des choses. Il faut savoir en effet que le budget de l’éducation croît de façon pléthorique depuis 20 ans, et que les problèmes n’en demeurent pas moins de plus en plus importants.
3°) Cette revendication est plus qu’imprécise. De l’argent, mais où ? Pour quoi ? Pour qui ? le mot d’ordre n’est pas clair. On parle de mal-être. Mais quand on évoque ses causes, les lycéens répondent : solidarité, ras-le-bol général… Cette incapacité des protagonistes à définir le sens de leur action peut s’expliquer par l’inexpérience des adolescents (pas facile à cet âge de savoir ce que l’on veut et surtout de savoir bien le formuler), par la complexité de la structure à laquelle ces lycéens appartiennent (l’Éducation Nationale), par la complexité des notions et des problèmes qu’ils affrontent (éducation, culture et savoir, avenir…) et, enfin, par la méconnaissance – largement entretenue dans leur environnement – des enjeux auxquels ces questions sont rattachées (on pense notamment aux conflits entre enseignants, syndicats, administration, ministère…). Elle appelle surtout cette dernière remarque :4°) Que les élèves soient incapables de formuler leurs revendications, sinon en des termes si classiques ou plutôt si usés qu’ils paraissent aujourd’hui inadaptés, ne doit pas empêcher de les écouter. Cela ne doit surtout pas autoriser enseignants et décideurs à se voiler la face! Car des questions qui ne sont pas formulées (ou qui sont mal formulées, comme nous allons le voir) ne sont pas forcément des questions qui n’ont pas lieu d’être posées.
Pour mieux comprendre, il nous faut revenir au centre des manifestations du 20 octobre dernier et écouter à nouveau les élèves. ‘On veut plus de classes, on veut plus de profs’ : tel est le slogan scandé par certains d’entre eux pour engager les hostilités. Un psychanalyste ne manquerait pas de relever que cette formule, à première vue tranchante et contient – en langage parlé du moins – sa négation , à savoir : ‘nous ne voulons plus de classes, nous ne voulons plus de profs.’ Loin de nous l’idée de croire que les élèves ne veulent plus travailler, mais, ne veulent-ils pas, en revanche, travailler autrement : ‘Nous voulons d’autres classes, nous voulons d’autres profs.’? Veulent-ils vraiment que rien ne bouge, sinon le nombre d’élèves par classe ou de profs par élève (ce qui revient au même) ? N’y a t-il pas derrière ce pseudo-lapsus un sorte de non-dit qui ne demanderait qu’à être formulé et à être entendu par tous ? Quand on se penche sur les résultats de la consultation lancée auprès des lycéens en 97, on s’aperçoit, en effet, que ces derniers demandaient un véritable allégement des programmes, un enseignement en partie individualisé, un soutien auprès des élèves en difficulté (mesures qui renforceraient l’efficacité de la méthode et qui réduiraient, pour le coup, les inégalités), un véritable système à options, une évolution des relations profs-élèves (parrainage)… Et lorsque, aujourd’hui, on entre un peu plus au coeur des cortèges de lycéens, on entend des appels plus profonds et cette fois-ci plus clairement formulés : ‘On nous trie, on nous entasse, on nous gave’, ou : ‘Nous refusons que l’éducation devienne une usine à bac, un parc à boeufs’, ou aussi : ‘On nous conditionne’ ou encore : ‘On nous conduit droit dans la poubelle de l’ANPE’*.
Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que le flou qui génère et nourrit ce mouvement est révélateur d’un grand trouble. Le ministre de l’Éducation, qui paraissait au départ prêt à faire bouger l’institution, a, face aux incertitudes ou à la menace, choisit finalement d’avancer son train de réformes à une allure de sénateur. Voyons plutôt :
1°) On donne un peu d’argent. Ce remède, a priori utile, pourrait bien, à long terme, s’avérer aussi illusoire que ces anti-inflammatoires que l’on prescrit trop souvent au malade, et ce sans avoir repéré les causes du mal.
2°/ On parle de démocratisation du lycée… Mais dans la réalité on assiste à bien peu de changements. A l’occasion de la consultation de 97, les lycéens s’étaient largement étendus sur ce sujet. Ils réclamaient beaucoup sur ce point. Aujourd’hui ils ne sont pas dupes : ils savent bien qu’on ne rend pas compte de leurs aspirations.
3°) On allège les programmes. Suppression de l’étude de l’histoire de la machine à vapeur en section scientifique (sic !). Moins de temps consacré à l’étude des détails en géographie afin de favoriser l’enseignement des acquis fondamentaux (double sic !). Suppression de l’étude d’un texte de Victor Hugo dans le cadre de la préparation au bac (triple sic !). L’allégement pourrait prêter le flanc à la moquerie (du genre : le mammouth va bien y laisser deux ou trois kilos)… Mais non, bien au contraire ! Certains (des enseignants en majorité) crient déjà au scandale, invoquant, ici le danger de dévalorisation qui guette le baccalauréat (c’est faire un grand honneur à Papin et à sa machine à vapeur), là l’inculture qui guette nos enfants (on parle même de ‘chute inexorable du niveau des connaissances’)!
Picaillons, feu de paille, coup d’épée dans l’eau, rustine posée sur une chambre à air vieille de plus de cent vingt ans : voilà bien ce que sont ces réformes .
Notre mammouth, on le voit, se porte bien. Il est toujours vivant, mais plus que jamais égaré dans un monde qui n’est plus le sien.
L’idée n’est pas de dire : ‘C’est mieux ailleurs’. Elle est de montrer qu’il existe d’autres objectifs, d’autres voies, d’autres conceptions de l’éducation et de la formation, d’autres alternatives. Ces ‘autres’, nous n’avons pas le droit, en cette fin de siècle, de les ignorer ou de les taire à notre jeunesse.
Trois Quatorze
* Source : ‘Le Monde’ : 15 octobre 98
Edito paru dans le journal Trois-Quatorze n°29