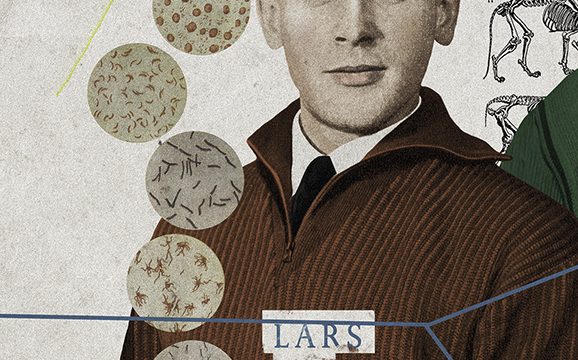Jean-Louis Berquer, président de l’association PIE et interprète, nous parle de son métier… et un peu de lui-même.
Jean-Louis Berquer, président de l’association PIE et interprète, nous parle de son métier… et un peu de lui-même.
Image : Jean-Louis Berquer, “interprété” par Laurindo Feliciano
Pas facile d’obtenir ce rendez-vous. Que d’appels, que d’hésitations. Il a fallu avancer beaucoup d’arguments pour le convaincre et l’amadouer, presque le rassurer. Il craignait sans doute qu’on le passe au crible. Alors on s’engage auprès de lui —lui l’interprète— à ne pas trop l’interpréter. On lui promet de ne pas tant parler de lui que de décrire son activité, en le laissant esquisser à grands traits les contours de celui qui s’y adonne.
Le rendez-vous du 12 janvier est repoussé au 13. Paris, ce jour-là, est plongé dans une grande tristesse. Tout le monde ne parle que du drame, survenu six jours auparavant au siège de Charlie Hebdo, une tragédie qui s’est prolongée dans les rues de Montrouge, puis en plein coeur de Vincennes. Paris, ce jour-là, ronge son deuil.
On se retrouve dans son quartier, au pied d’un immeuble récent, planté aux abords des Buttes-Chaumont. On franchit la porte, on grimpe huit étages, histoire de retrouver un peu de hauteur et de lumière. Grand balcon ouvert sur le parc: la vue est dégagée, on respire. On craignait qu’il soit peu disert, or, pendant plus de deux heures, il va nous parler presque sans s’interrompre; il va s’étendre, prendre des chemins de traverse, parfois s’égarer, souvent nous perdre. Il sourit: «Je ne sais pas comment tu vas t’y retrouver dans tout ça.» Le personnage ne manque pas de malice, qui va parvenir, au bout du compte, et à force de touches et de reprises, à nous livrer un portrait pointilliste, mais très expressif… de l’interprète.
Beau métier que le sien, qui consiste à « permettre à des gens qui ne parlent pas la même langue de se comprendre et de communiquer. » Projet titanesque aux contours pour le moins babelesques.
Si son portrait a une colonne vertébrale —à l’évidence, la relation à la langue étrangère et à sa compréhension—, il prend d’emblée un malin plaisir à nous la cacher. Au final seulement il nous dira: «La langue c’est l’évidence: c’est la chose première et indispensable. Si vous n’êtes pas parfaitement à l’aise dans la compréhension et dans l’expression, c’est mort.» On insiste: «Autrement dit, pour être interprète, il faut être bilingue?» Il esquive: «Il y a des gens qui ont deux langues maternelles ou qui ont appris dans la prime enfance en vivant dans un pays étranger…» Pour eux, c’est évidemment plus simple… À l’évidence, ce n’est pas son cas: «Moi, l’anglais m’a toujours parlé (on souligne le verbe et on s’amuse de son emploi), mais mes deux parents sont Français et francophones. Je suis né à Amiens et dans le coin on était plus sensibilisé qu’ailleurs à cette langue du fait de la proximité de l’Angleterre et du fait de la guerre.» On croit moyennement à cette explication. On comprend mieux quand il nous explique qu’à l’école «[il] aimait les langues (l’anglais et l’italien également) et que lorsqu’un jour de l’automne 1971 quelqu’un est venu dans son lycée et a évoqué cette possibilité de partir une année aux USA, [il] s’est aussitôt projeté et engagé dans l’aventure.» Il reconnaît que quand il est arrivé là-bas, il a compris que malgré son bon niveau scolaire, «il y avait tout à faire.» Il ouvre alors une longue parenthèse pour évoquer la faiblesse du niveau de langue en France —due en partie au peu d’attention que notre école accorde à cette matière («il suffit, dit-il, de comparer les coefficients en langue et dans les matières scientifiques pour expliquer ce phénomène»—, mais préfère, tout compte fait, rejeter le sujet d’un revers de main agité et dédaigneux. Il nous explique par contre tout l’intérêt qu’il y a à partir le plus tôt possible à l’étranger. Il est formel: le bénéfice à 15-16 ans n’est pas du tout le même qu’à 20-25. À cet âge, le cerveau semble plus souple et plus modelable, l’oreille plus fine. «Et la langue, pratiquée et vécue au quotidien, en famille et à l’école, au milieu d’autres adolescents —sous-entendu: avec la télé, le barbecue et les disputes familiales en bruit de fond— est une chose absolument primordiale… et qui n’a pas d’équivalent.» Il compare avec les autres moyens d’apprentissage (type année universitaire, au milieu de beaucoup d’étudiants étrangers et basée sur l’apprentissage d’un anglais plus technique) pour conclure que les acquis dans ce cadre scolaire sont bien plus importants. Quant aux cours d’anglais que l’on prend sur le tard, histoire de se débrouiller dans le cadre professionnel, il ne semble pas y croire. Il fait la moue quand on en parle, en ajoutant : «Oui, on acquiert certaines choses, mais ça reste très flou.» Et d’énumérer les imprécisions: «Les problèmes d’accent et de compréhension… Certains sauvent les meubles, mais la plupart sont très durs à suivre quand ils s’expriment en anglais… très fatigants!»
«La maîtrise de la langue, insiste-t-il, c’est le b.a.-ba du métier. Tout part de là, mais ce n’est pas l’Omega.» Tout discours, en effet, a une dimension implicite, qui impose à l’interprète de ne pas se limiter au sens littéral, mais de conserver et de transmettre fidèlement le sens caché du discours original. Il faut saisir les intentions et savoir les transmettre, savoir entendre et retranscrire, devancer et corriger… Pour bien comprendre les enjeux et pour affiner le (son) portrait, on lui propose d’énumérer les qualités indispensables que doit posséder l’interprète.
Une bonne mémoire semble essentielle. Il ne le dit pas —puisqu’il parle de l’interprète en général— mais c’est une qualité qu’il possède à l’évidence. Il suffit pour s’en convaincre de l’écouter évoquer cette journée de 1971 où il part faire son entretien de sélection à Paris (en vue de son départ pour les USA), ou celle de 1979, où Laurent Bachelot (actuel délégué général de PIE, avec qui il fondera l’association) lui parle pour la première fois de l’ESIT. Dans un cas comme dans l’autre il se souvient du moindre détail : «C’était le jour d’un important match de rugby (sic !)», ou encore: «Il faisait froid ce jour-là»; et de préciser dans la foulée, l’heure et le nom de la rue, et le chemin parcouru pour parvenir à destination (sic!). À la bonne mémoire, il associe la nécessaire ouverture d’esprit et son corollaire, la curiosité. Quand, pour mieux comprendre, on lui demande à quoi il s’intéresse personnellement, il répond : «À rien» (entendez à «rien de particulier», autrement dit «à tout») et si on lui demande: «Qu’est ce qui ne t’intéresse pas?» sans hésiter, il répond également : «Rien!» À l’évidence donc, tout l’intéresse. Il ajoute: «Pour être un bon interprète il faut avoir l’esprit Wikipedia — les anciens diraient l’esprit “ Quid ” —: Je suis capable de m’intéresser à un prospectus de présentation d’une machine à laver, à un geste sportif, à l’industrie de la pêche à la baleine ou à la culture du lin…» «Sur tout, dit-il, il faut accepter d’avoir une vision d’ensemble, mais il faut aussi savoir picorer, survoler. Pas le temps d’approfondir.» Il marque un temps: «Je ne pense pas qu’un monomaniaque ferait un bon interprète.» Un brin moqueur, il ajoute: «En général un interprète peut briller dans une conversation de salon ! C’est un peu la culture “vernis”. Mais, il faut bien comprendre que si vous ne connaissez pas le nom du premier ministre anglais, à un moment ou un autre, vous serez coincé!».
Il en vient maintenant à la culture… la vraie. La culture au sens de la compréhension d’une société, de ses valeurs, de ses nuances et de ses différences. La culture qui soude et qui fonde un pays, un peuple, un monde: «Si vous ne connaissez pas le milieu de vos interlocuteurs, même si vous saisissez les mots, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qu’ils racontent. Prenons l’exemple des Américains : ils commencent toujours leurs discours par une blague, qui porte en général sur le baseball, le football américain ou sur un talkshow. Si vous ne maîtrisez pas un minimum cette culture, vous êtes tout de suite perdu et vous ne pouvez pas retranscrire leur pensée. Il faut absolument avoir intégré certaines choses. » On repense aussitôt à son année passée à l’étranger et on devine à quel point elle lui a été précieuse. Il nous confirme qu’elle «lui a permis de se mettre en phase avec le pays et donc sa langue, au sens où elle lui a permis de saisir nombre de ses subtilités.» Pour clore sur ce point, on évoque cette collègue qui, alors qu’elle traduisait le discours d’intronisation du pape, n’a pas réalisé —parce qu’elle ne le connaissait pas— qu’à un moment donné, il entamait le « Notre père », et qui s’est donc mis à le traduire. Elle s’est emmêlé les pinceaux et les auditeurs n’ont pas retrouvé le texte qu’ils connaissaient par coeur. «Dans ce cas, elle aurait dû éteindre son micro et laisser le pape faire la prière en italien ou en latin. Oui, conclut-il, ce jour-là, elle a été confrontée à un problème purement culturel !»
Il faut aussi, pour rendre le propos dans sa globalité et saisir tous les aspects du discours, faire preuve avant tout d’une grande capacité d’analyse : savoir entendre au-delà de chaque mot, saisir la phrase dans son ensemble et l’intégrer dans la totalité du discours. Et savoir même devancer et corriger. Il livre alors cette anecdote saisissante d’un conférencier qui pendant une traduction s’adresse à son interprète sur un ton de reproche: «Mais, ce n’est pas ce que j’ai dit!» ; et l’interprète de lui rétorquer: «Non, mais c’est ce que vous avez voulu dire!»
L’interprète doit aussi faire preuve d’empathie, il doit pouvoir comprendre et transmettre les sentiments et les volontés de l’autre, «savoir se glisser dans ses souliers.» Il faut être un peu acteur, savoir «adopter le ton, le débit, l’énergie de celui qu’on traduit… sans lui nuire, en le valorisant plutôt.» Et d’ajouter aussitôt: «Mais en veillant à ne pas en faire trop non plus.» Car, «il faut aussi rester fidèle!»
Jean-Louis ne s’arrête plus; il veut tout nous dire de son métier, il veut affiner sa description: alors il avance, revient en arrière, ajoute un qualificatif, puis l’ôte; il adoucit ou durcit les lignes, il se reprend; c’est maintenant un sculpteur qui pose et qui retire de la glaise. Le personnage de l’interprète apparaît donc, puis s’estompe… pour finalement refaire surface de façon plus nette et plus précise. Jean-Louis veut maintenant nous faire comprendre le processus de traduction dans son ensemble. «Dans l’ordre, dit-il, il s’agit: 1°/ d’écouter ; 2°/ d’entendre (comprendre et analyser) ; 3°/ de traduire ; 4°/ de restituer oralement ; 5°/ de s’entendre parler (car si on n’entend pas ce que l’on dit, on fait des fautes de français, on ne finit pas ses phrases, on devient inaudible…» Et de préciser aussitôt: «Mais, attention, il faut bien comprendre que l’on fait les 5 actions à la fois successivement et simultanément, car pendant qu’on est dans la phase 4 et 5 on continue à écouter la suite du discours du conférencier (phase 1)… et à la traduire (phase 3)…» Le parallèle avec un musicien —que l’on nomme d’ailleurs interprète— saute alors aux yeux: déchiffrer une partition, la jouer, en maîtrisant parfaitement le son que l’on produit (autrement dit en entendant ce que l’on fait mais sans «s’écouter» —autrement dit, sans s’appesantir sur ce que l’on dit). L’interprète est à la fois une oreille et un émetteur. Il déchiffre et exprime.
On s’interroge alors sur la question de la vitesse d’exécution. Il nous rétorque: «C’est un point essentiel. Peut-être la plus grande difficulté.» Quand on connaît un tant soit peu le personnage, on se doute qu’il est le candidat parfait : Jean-Louis est vif, nerveux, sa pensée est toujours sur le qui-vive, ses mots sortent en rafales. Dès que vous avez ouvert la bouche, il attend la suite, car il a déjà deviné ce que vous allez dire… Sans doute une déformation professionnelle.
La concentration : il re-connaît qu’elle est extrême: «On explique aux élèves/interprètes que seul le métier d’aiguilleur du ciel en requiert autant. C’est pour cela que nous travaillons par équipe de deux. On se relaie toutes les 20-30 minutes, et on est toujours prêt à venir en aide à l’autre.» L’interprète est un sportif de haut niveau —un sprinteur cérébral qui travaille en fractionné. «Les neurologues prétendent que le cerveau humain n’est pas fait pour ça.» Comme si traduire en simultané relevait de la schizophrénie: «Ce qui est certain, c’est que pendant l’intervention, la fièvre monte. On est comme en transe.»
Il nous parle encore des ficelles du métier, «sans lesquelles on ne s’en sortirait pas»; du vide existentiel qui saisit l’interprète quand il a un trou ou quand il décroche… des fous rires du métier (il pense à ce chef d’entreprise qui, « dans un anglais déplorable s’est mis à parler de “l’Atriti” (un mot inconnu de l’interprète, jusqu’à ce que ce dernier comprenne, à la vue d’une diapositive, qu’il s’agissait de l’Airbus A 380 —en anglais: “A Three Eighty”»)… ; et aussi de la traduction consécutive —qui consiste à traduire de façon continue après que le discours est fini— qui ne se pratique plus, mais qui est la base du métier; et puis de l’apparition de la traduction simultanée (au procès de Nuremberg).
Il voudrait affiner son dessin, nous conter mille anecdotes, mais nous n’avons plus d’espace et plus guère de temps. Même pas celui nécessaire pour l’interroger sur son statut de Président de PIE. On se dit alors qu’on se reverra. Pour l’instant, sachons seulement que cette présidence, acceptée en 2010, est la conséquence de la fidélité de Jean-Louis aux séjours de longue durée, à Laurent Bachelot son délégué général, et à la passion de «l’interprète» pour les langues et les échanges de toutes sortes.En sortant, on demande à Jean-Louis, presque comme un défi, de nous traduire : « Je suis Charlie »? On le voit alors qui se concentre, on entend son cerveau qui bout… et la réponse fuse: «Je suis Charlie!»
Article paru dans le Trois Quatorze n° 55